Il était une fois deux livres sur Sergio Leone
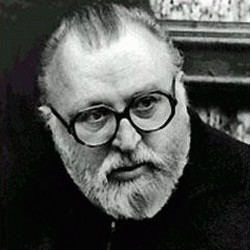
Bonne nouvelle pour les cinéphiles, deux nouveaux livres viennent de sortir sur Sergio Leone, parus en novembre 2010. L’un est consacré à Il était une fois dans l’Ouest (1968) : Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, par Philippe Ortoli, aux éditions de la transparence, et l’autre à Il était une fois en Amérique (1983) : Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, le temps où nous rêvions, par Jean-Marie Samocki, aux éditions Yellow Now. Que dire de neuf sur le légendaire Sergio Leone (1929-1989) ? Tâche difficile, d’autant plus que, concernant sa poignée de westerns – cinq seulement au compteur -, le sentier est déjà bien balisé avec quelques publications mémorables : le passionnant Sergio Leone de Gilles Cèbe (1984, éd. Henri Veyrier), le très précis Sergio Leone, le Jeu de l’Ouest par Oreste de Fornari (1997, éd. Gremese) et le foisonnant Il était une fois en Italie, les westerns de Sergio Leone par Christopher Frayling (2005, éd. de
Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone n’est par le 1er livre consacré à Leone par Philippe Ortoli, universitaire corse. On lui doit Sergio Leone, une Amérique de légendes (1994, éd. L’Harmattan) qui se proposait de montrer à quel point Leone est un inventeur de formes et de mythes - il y écrivait notamment ceci : « A l’heure où la télévision fabrique de fausses idoles à la minute, il peut être salutaire de ressentir souffler le vent authentique de l’héroïsme » et, à la vue des figures iconiques du maître italien (Blondin, Sentenza, Tuco, Frank, Harmonica, Cheyenne, Jill et j’en passe), on ne peut que lui donner raison. Ce bouquin offrait la particularité d’intégrer au corpus de westerns de Leone Mon nom est Personne, pourtant réalisé par Tonino Valerii en 1973. Mais le statut de star de Leone était déjà tel à l’époque qu’il a suffi que Sergio réalise quelques scènes du film pour que d’aucuns lui attribuent aussitôt la paternité du film. Tonino Valerii, certes son nom n’est pas personne, mais il a de toute évidence pâti du fait que rien ne pousse jamais vraiment à l’ombre des grands arbres. Avec le temps, il n'en était d’ailleurs pas dupe, déclarant ceci à Oreste de Fornari en 1984 : « Leone proposa de diriger la deuxième équipe, en tournant quelques scènes avec Terence Hill (qui avait rudement envie de travailler avec le "maestro"). Mancini, l’organisateur, m’avait prévenu : " Si tu laisses tourner une seule scène à Leone, tout le monde dira que c’est lui qui a fait le film ". Je ne l’ai pas écouté, je ne voulais surtout pas causer un ennui financier à Leone, en retardant la fin du tournage. Mais c’est exactement ce qui se passa. A la sortie du film (qui a encaissé sur le marché international plus que n’importe quel autre film de Leone), beaucoup de critiques ont parlé de Leone comme de l’auteur et de moi comme d’un exécutant, d’un copiste. Et Steven Spielberg juge Mon nom est personne comme le chef-d’œuvre de Sergio Leone ! ».
Dans son Il était une fois dans l’Ouest, Ortoli ne manque pas de rappeler que Leone a pu être aimé ou détesté sur des malentendus. Celui que le philosophe Baudrillard a qualifié de « premier cinéaste postmoderne » n’est pas qu’un petit malin qui aurait perverti l’imagerie westernienne hollywoodienne pour « muer les preux chevaliers en mercenaires cupides » (Ortoli). Leone, ironique, arlequin cynique, citationnel, cruel, pourquoi pas. Mais ne le voir que sous cet angle-là (un cinéaste transalpin, ex-gamin du quartier populaire du Trastevere (Rome), qui aurait tout simplement italianisé le western américain pour y placer ses personnages picaresques à l’italienne), ce serait passer à côté de la dimension poétique du romantique mortifère qu’il était. Cinéaste du temps retrouvé (cf. les incessants flashback), Leone, en contemporain de Visconti, n’a pas retenu de celui-ci que les beaux rideaux qui flottent au vent, il nous parle également de la fin d’un monde avec des valeurs, des classiques et des héros d’un autre temps ; il y a de la madeleine proustienne et du Guépard chez Leone. Mais le plus intéressant dans le Il était une fois dans l’Ouest de P. Ortoli n’est pas ceci, car cette lecture-là (mettre en avant chez Leone le grand mélancolique qui croyait naïvement en une Geste héroïque plutôt que le postmoderne cynique dynamiteur de mythes) n’est pas bien nouvelle en soi. Le plus intéressant, donc, c’est lorsque l’auteur parle du cinéma de Leone comme d’un « territoire de l’entre-deux », à savoir un cinéma basé sur l’ellipse et le manque. En grand cinéaste, Leone savait qu’il fallait préserver le mystère en intégrant des trous dans sa dramaturgie afin qu’ils soient complétés par le regardeur. A l’heure où moult objets télévisuels nous montrent avec voyeurisme tout sous tous les angles, il est bon de revoir un film de Leone pour se rendre compte à quel point celui-ci faisait confiance au spectateur pour qu’il se fasse son propre film en comblant les béances narratives qui s’y trouvent. Leone, et c’est l’une de ses marques de fabrique manifestes, s’attarde en apparence sur des détails insignifiants (une mouche agaçante, un château d’eau grinçant…) et coupe sans vergogne des scènes qui auraient pu s’avérer spectaculaires. Comme le rappelle Ortoli, lorsque Cheyenne/Robards entre dans la taverne, on devine qu’avant, il s’est débarrassé des hommes qui l’escortaient parce qu’on entend des coups de feu, mais on ne voit pas la scène. De même, l’attaque du train du capitaliste corrompu Morton par les hommes de Cheyenne n’est pas montrée : on n’en voit que le résultat. Il circule tellement de versions intégrales ou raccourcies des films de Leone qu’on prend toujours un vif plaisir à les revoir maintes et maintes fois car on rêve de découvrir des séquences qu’on aurait manquées, allant même jusqu’à imaginer que des scènes absentes de la version du film regardée existent quelque part et ont bien été tournées alors que Leone ne les a jamais filmées ! Ortoli cite ainsi une plume (Ph. Setbon, Charles Bronson) de 1978 qui fantasmait une scène jamais tournée : « Le film, resté de nombreuses années en exclusivité à Paris, est victime de nombreuses coupures : en particulier la scène de l’attaque du train par les hommes de Robards, absente de toutes les copies françaises (même en V.O.) ». Bref, avec Leone, on refait sans cesse le film et c’est pour cela, entre autres, que son œuvre perdure dans le temps car le maestro y a placé des ellipses et des zones de mystère qui font que ses films restent en mémoire tout autant par ce qu’ils montrent que par ce qu’ils ne montrent pas. Philippe Ortoli n’est pas le premier à parler de cette « image perdue » qui hante le cinéma de Leone mais, en quelques pages passionnantes (pages 57/66), cet auteur développe avec brio cette idée-là, ça vaut donc le coup d’être signalé et salué.
L’espace mental du spectateur qui continue le film longtemps après l’avoir vu, puis l’espace mental des personnages filmiques : plus que jamais ces deux espaces entrent en résonance dans l’inoubliable Il était une fois en Amérique de l’ami Leone. Que dire sur ce monument du cinéma ? Si ce n’est qu’on n’a pas vu un film pareil, avec une telle ampleur narrative et un tel parfum mythologique, depuis environ une trentaine d’années, à savoir depuis 1983, l’année de sa sortie. « Le temps où nous rêvions » est le sous-titre judicieux du livre de Jean-Marie Samocki, enseignant et écrivain de cinéma, consacré au film-testament de Leone. Comme attendu, et il serait difficile de faire autrement car le temps retrouvé, perdu ou halluciné est la figure centrale de ce film proustien par excellence, l’auteur s’attarde sur les écheveaux spatio-temporels qui font baigner le film dans un no man’s land, entre 1922, 1932 et 1968. Ce film de gangsters narrant l’histoire d’une amitié trahie - le tortueux Max (James Woods) a pris l’argent et la femme du sentimental Noodles (Robert De Niro) - vient se lover dans une fumerie d’opium du Lower East Side de New York. L’opium qui, entre autres choses, offre la particularité de brouiller les repères temporels (le futur devient le passé…) fait qu’on entre dans le cerveau embrumé du mélancolique Noodles. Ce grand nostalgique, à la mémoire imaginative, préfère baigner dans ses souvenirs, dont certains enjolivés, plutôt que d’avoir à se coltiner une réalité triviale et décevante. « Le souvenir est le seul paradis dont on ne puisse être chassé » : Noodles applique cette maxime à la lettre, à jamais à La recherche du temps perdu. On peut lire les 3 heures 46 de Il était une fois en Amérique comme une longue rêverie opiacée nous maintenant dans un flottement permanent. La fumerie, avec son théâtre d’ombres, étant à la fois une métaphore de la dualité entre Max et Noodles (les ombres chinoises se chamaillent tels Abel et Caïn, dixit Samocki), du 7e art (le cinéma comme paradis artificiel), ainsi qu’une possible métaphore de la vie, parce qu’on est amené à se construire une identité via des va-et-vient constants entre passé, présent et futur. Avec talent, J-M. Samocki nous rappelle la construction alambiquée du film, profondément propice aux rêveries mélancoliques et aux ambiances ouateuses, confinant à un blanc comme le linceul.
Néanmoins, on peut lui reprocher quelques afféteries : Pourquoi dans son livre ne citer les dialogues du film qu’en anglais et sans prendre la peine de les traduire alors que Leone était connu pour suivre de très près toutes les versions, et notamment françaises, qui sortaient de ses films ? Les dialogues en langue française de l’ultime film de Leone sont excellents, on pouvait largement s’en contenter. Et pourquoi émettre des doutes là où le cinéaste a apporté des précisions claires ? Exemple, page 33, l’auteur écrit « Peut-être Leone soumet-il la fiction à la mémoire de son personnage. » Or Leone l’a clairement indiqué dans ses Conversations avec Simsolo : « On marche ensemble. Noodles avec son rêve. Et moi avec le mien. Ce sont deux poèmes qui fusionnent. Car, en ce qui me concerne, Noodles n’est jamais sorti de 1930. Il rêve tout. Tout le film est le rêve d’opium de Noodles à travers lequel je rêve les fantômes du cinéma et du mythe américains. » Dernière chose, Samocki consacre avec pertinence quelques pages aux films qui auraient une dette envers Leone, si certains sont attendus (Miller’s Crossing des Coen, Jackie Brown de Tarantino…), d’autres sont inattendus et bienvenus, tels que A History of violence (2005) de Cronenberg pour la rencontre finale entre Joey et Richie rappelant celle de Noodles et Max dans le Leone ou encore L’Etrange histoire de Benjamin Button (2008) pour la compilation des temps – je l’avais moi-même mentionné ici : http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-fabuleux-destin-de-benjamin-51977. Par contre, lorsque J-M. Samocki dresse un parallèle possible entre
