Quand la Chine s’arrêta
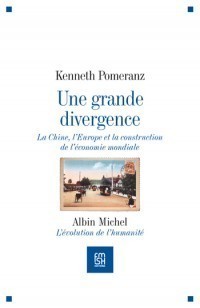
- Point d’histoire : Le jour où la Chine s’est endormie
Le grand bond sur place...ou les chances de l’Angleterre
Un débat qui agite le monde des historiens, relancé par l’étude de K.POMERANZ :
Je l’avoue sans honte, je n’ai pas (encore) lu ce livre, récemment traduit,mais cela ne va pas tarder. Pour ce que j’ai parcouru le concernant , je pense qu’il apporte vraiment du nouveau. La preuve, il sollicite l’intérêt des meilleurs historiens , qui saluent la richesse de ses analyses, tout en n’étant pas tous en accord , du moins totalement, avec ses conclusions. Ma seule ambition est de donner l’envie de s’y plonger, pour y revenir plus tard afin de confronter les points de vue.
On comprend encore assez mal, malgré les études historiques nombreuses, pourquoi la Chine, très en avance sur l’Europe au 18° siècle dans de nombreux domaines, n’ait pas été entraînée dans le sillage du mouvement d’industrialisation qui a caractérisé les nations européennes, notamment l’Angleterre, qui a connu rapidement une révolution exceptionnelle.
-Dans son incontournable Le monde chinois,le grand spécialiste de la Chine Jacques Gernet remet en question certains mythes anciens et encore actuels sur l’histoire complexe et fascinante de la Chine :
« La Chine entre au 18°s dans une ère de prospérité qui est due à un essor agricole, artisanal et commercial sans précédent. Elles devance largement toutes les autres nations pour le volume de ses productions et de ses échanges intérieurs.L’agriculture chinoise atteint son plus haut degré de développement. Par ses techniques,la diversité des espèces cultivées, ses rendements, elle apparaît comme la plus savante et la plus évoluée de l’histoire avant l’apparition de l’agronomie moderne...Par comparaison, l’agriculture de nombreuses régions d’Europe de la même époque peut paraître singulièrement arriérée. Le paysan chinois de l’ère Yongzheng et de la première moitié de l’ère Qianlong est, d’une façon générale, bien mieux nourri et plus à son aise que son homologue français du règne de Louis 15. Il est aussi généralement plus instruit...Cet essor si remarquable de l’agriculture chinoise au 18°s. , stimulé d’ailleurs par l’essor concomitant de la production artisanale et des trafics commerciaux, invite à réviser certains jugements d’aujourd’hui... »(p 237 sq -ed Agora)
-Il décrit l’extraordinaire développement de la Chine à cette époque, notamment le développement exceptionnel d’une industrie efficace (les cotonnades de Songjiang emploient en permanence 200000 ouvriers, par exemple, aux hauts fourneaux de Hhei travaillent 2000 à 3000personnes). La Chine commerce avec le monde entier.. Le développement démographique est spectaculaire, un service public efficace est en place...Déjà, dit D.Donatien, "Au XIe siècle, la Chine produit environ 120 000 tonnes de fonte de fer, la Grande-Bretagne 70 000 tonnes à la fin du XVIIIe. Le monde doit presque tout à la Chine sur le plan de l’innovation technique, mais aussi au plan des conceptions modernes de l’Etat : les concours de recrutement de fonctionnaires implantant un service de l’Etat centralisé, accompli par des individus révocables et non par des féodaux héréditaires.C’est en élargissant sa sphère de domination vers le sud du Yangzi, au Guangdong, puis au Vietnam que la Chine se dota d’une marine et que les échanges maritimes crûrent en volume. Les expéditions conduisirent à la domination des pays maritimes de la région de Canton, jusqu’à la région de Hué et Da-Nang..."
Comment expliquer alors le fait que la Chine n’ait pas naturellement suivi le modèle européen et notamment la révolution industrielle anglaise dès la fin du 18°siècle, dont le moteur essentiel fut l’exploitation du charbon et le règne de la machine à vapeur, force productive de premier plan, qui a entraîné les conséquences en chaîne que l’on sait ?
Gernet, comme d’autres, pointe l’excès de centralisation, l’Etat vivant au dessus de ses moyens, la corruption, les guerres lointaines, l’assoupissement lié à l’euphorie du développement, un certain essoufflement d’une économie prospère mais routinière , l’insuffisance progressive des terres liée à la croissance démographique, etc...
Mais cette interprétation traditionnelle est aujourd’hui discutée, approfondie et remaniée...
-Pomeranz, dans son livre récemment traduit en français,remet en cause l’européocentrisme qui a prévalu dans l’explication du « décrochage » de la Chine par rapport à certains pays d’Europe. L’avance industrielle de l’Angleterre ne serait qu’une question de chance, pas de supériorité culturelle.
« Certaines régions d’Asie et d’Europe avaient atteint, à la fin du XVIIIe siècle, un niveau de développement comparable. Comment expliquer alors la distance qui sépara les deux espaces par la suite, et pourquoi la révolution industrielle eut-elle lieu en Grande-Bretagne plutôt qu’en Chine ? Par une sorte de hasard écologique et conjoncturel, répond Pomeranz : la disponibilité des ressources en charbon et l’exploitation du Nouveau Monde sont les deux principaux phénomènes à l’origine de cette « grande divergence ». ...C’est en partant du constat d’un « fossé injustifié entre nos façons de qualifier des phénomènes qui, aux deux extrémités de l’Eurasie, étaient de même nature » que Pomeranz entreprend de démontrer les similitudes et les points de convergence entre certaines « régions-centres » de l’Ancien Monde au XVIIIe siècle. Le delta du Yangzi en Chine, la plaine du Kantô au Japon, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Gujarat en Inde présentaient des « ressemblances étonnantes », en termes démographiques par exemple. La consommation de produits de luxe était « au moins aussi répandue parmi les diverses classes de Chinois et de Japonais que parmi les Européens ». La Chine importait toutes sortes de produits exotiques, perles d’Asie, lorgnons venus d’Occident et fourrures de Russie. En outre, l’Europe semblait moins efficace dans certains domaines considérés traditionnellement comme les facteurs du dynamisme économique, tels l’organisation des marchés et la division du travail. Ces différentes régions avaient donc atteint, à la fin du XVIIIe siècle, des limites comparables : elles étaient toutes « en marche vers un commun cul-de-sac « proto-industriel » où la production (…) parvenait tout juste à devancer la croissance démographique « .Dès lors, pourquoi l’Europe fut-elle le berceau de la révolution industrielle et pas la Chine ? D’abord, selon Pomeranz, la « chance » de la Grande-Bretagne fut de disposer d’importants gisements de charbon à proximité des lieux de l’activité économique, quand les ressources chinoises étaient éloignées des grandes régions de production. Au XIXe siècle, le combustible fossile joua donc le rôle de « substitut de la terre », au moment où on ne parvenait plus à accroître ses rendements. La seconde cause est à chercher dans l’exploitation de l’Amérique coloniale, riche de matières premières, et sans population pour les consommer. Selon lui, la croissance ne fut donc pas seulement endogène, mais rendue possible par des ressources extérieures. Enfin, insiste Pomeranz, ce n’est pas avant le milieu du XIXe siècle que l’Europe « devint cette monstruosité cousue d’or ».
La divergence fut donc tardive.
Que penser de cette interprétation audacieuse, qui en a séduit beaucoup ? Tous les historiens ne partagent pas , ou pas tout à fait ce point de vue novateur , tout en reconnaissant la richesse des analyses.
"...Ce livre constitue l’un des premiers ouvrages de référence de la global history (histoire globale ou mondiale), programme de recherche séduisant mais dont la mise en oeuvre n’est pas toujours aisée. Pomeranz montre tout l’intérêt de dépasser les cadres nationaux pour mener à bien le travail comparatiste, en choisissant d’étudier des « régions-centres ». Cette optique transnationale invite à considérer un monde décloisonné et une histoire décentrée, qui ne fait ni de l’Europe ni de la Chine le coeur des processus historiques. C’est en abordant une pluralité d’espaces que l’historien met en perspective des réalités jusqu’alors déconnectées. __En refusant de postuler la supériorité des valeurs européennes, et en particulier une « opposition théorique entre souverains tempérés (d’Occident) et absolus (d’Orient) », Pomeranz n’écarte pas pour autant les explications culturelles ou politiques. Mais il balaie définitivement le grand roman d’un Occident éclairé contre le reste du monde obscurantiste et inadapté à la modernité. La thèse, nécessairement simplifiée ici, est d’une infinie richesse, et envisage le processus historique et économique dans toute sa complexité. __Rarement un ouvrage aura provoqué autant d’engouement, y compris chez ceux qui en ont critiqué certains aspects. Depuis sa publication, il y a dix ans, il n’a cessé d’alimenter, à l’échelle de la planète, les échanges intellectuels des historiens et des économistes. Espérons que cette traduction lancera à présent la discussion dans le monde francophone, resté jusqu’alors en marge d’un débat pourtant essentiel. A tous ceux qui regrettent parfois l’incapacité des historiens, de nos jours, à se mesurer à de « grandes questions », voilà en tout cas une oeuvre qui devrait donner une immense satisfaction." (Claire Judde de Larivière)



