… C’était à n’y comprendre rien
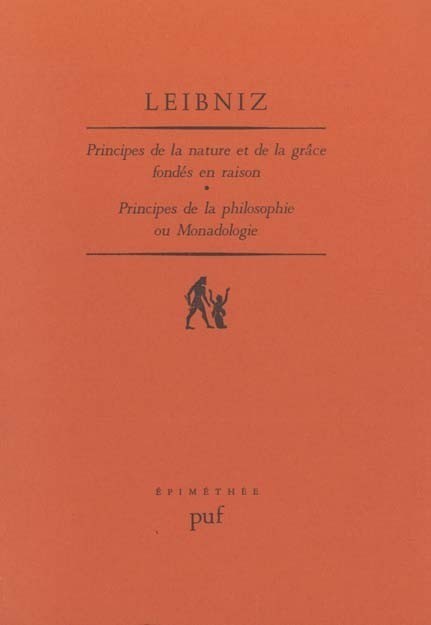
« La vieille s’est brûlée avec sa soupe, maintenant elle souffle même sur le yaourt ». En guise d’introduction, il est possible de remplacer ce dicton populaire par la phrase du mathématicien George Boole : « … notre conviction ne continuera pas d’augmenter avec l’expérience dans ses vérifications pratiques ». L’auteur du Traité sur le calcul des différences finies explique « qu’on ne pense que sur ce que l’on sait ». Si, de manière cavalière, on renverse l’équation : moins on sait, moins on pense.
Au dix neuvième siècle, la pensée se donnait le temps. Entre la révolution française, 1848, la naissance des nations, la déstabilisation des empires et les guerres, c’est-à-dire un temps tout aussi perturbé que le nôtre, la pensée allemande, les héritiers des lumières françaises, se payaient le luxe de quelques anachorètes qui, en développant le champ du savoir, démultipliaient celui de la pensée.
Or, qu’observons nous aujourd’hui ? Au nom du savoir et des principes considérés immuables nés au XIXe siècle d’une part, au nom de l’efficacité instantanée d’autre part, on s’assied sur une volonté d’agir dans le cadre prédéfini de nos certitudes. Celles-ci s’avérant insuffisantes, elles se transforment en réactions pavloviennes et en peurs en tout genre. La pensée n’étant pas l ‘accumulation répétitive de pensifs galvaudés et la pensée technicienne (la seule qui avance à grands pas), n’étant pas la seule à distribuer du savoir, nos sociétés s’installent dans la perpétuation de l’urgence. En d’autre termes, en non-connaissance de cause, on agit d’abord et on ne réfléchit pas après. Les grandes décisions, celles qui détermineront notre futur sont prises dans la panique, par dessus la jambe, basées sur de l’à peu près. Toutes les questions, celle du système financier, des révoltes du monde arabo-musulman, de la sécurité sociale, des frappes aériennes ou de l’intervention en Afghanistan, celles qui concernent l’énergie, l’eau, la mondialisation ou le mariage homosexuel, le désastre des cités ou la politique du logement, pour ne donner que quelques exemples, se posent au jour le jour, sans hiérarchie, avec comme unique fondement l’urgence qui les présente à notre entendement. Ce au-jour-le-jour, délaissé à une pensée technicienne- technocratique et gestionnaire, occulte en fait la notion du temps : Quarante années de crise économique et financière, de montée du chômage, dix années de guerre à Kaboul, trente années de progression, chaque jour plus vertigineuse, des loyers et du prix de l’immobilier, autant d’années de crise du système éducatif, vingt ans d’actes terroristes, plus d’un demi siècle de crise moyen orientale, un siècle de politique prohibitionniste sur les drogues, sont traités avec la désinvolture d’un phénomène nouveau-né, avec les mêmes décisions à la clé, les mêmes erreurs répétitives, sans que jamais on n’ y introduise la durée comme facteur pouvant mettre en cause ces politiques. Comme si, en frappant avec sa tête un mur de béton, et au sacrifice d’un nombre incalculable de têtes, le mur aurait une chance de céder.
Certes, ici et là la pensée se développe : on parle du « déni des cultures » qui, de manière volontariste, refuse le savoir exact d’un phénomène, des « bâtards de Voltaire » qui gèrent un héritage déformé sans jamais le faire avancer, de « la production de l’espace » et de sa relation avec les sociétés qui le conçoivent, de « la dictature de l’urgence », ou, à travers « un voyage aux pays du coton » on esquisse les mécanismes de la mondialisation.
Mais, une fois de plus, ces ouvrages seront broyés, comme tant d’autres non cités, non pas par des autodafés fanatiques, mais bien au contraire par une sur-exposition éphémère et télévisuelle qui se refuse tout travail d’hiérarchisation. Les pensées importantes du jour seront remplacées par celle de la prochaine émission télévisée. Ce déni militant d’hiérarchiser finit par introduire une double réalité, deux mondes parallèles : à quoi sert donc Foucault et son surveiller et punir à quoi sert l’histoire des savoirs sur le crime et la peine enseignés à la faculté, si on pond trois propositions de loi par jour sur le sujet, quitte à en abandonner (sous la pression de l’urgence politique) une ou deux au passage ?
Ainsi, au sein de ce désert de la pensée qu’est devenue la politique, ceux qui crient leurs peurs et leurs angoisses surfaites deviennent les ténors, les détenteurs de décisions sous forme de décalcomanies, au mépris intéressé des oasis toutes proches rebaptisées mirages.
A suivre…

