De la bipolarisation des concepts historiques
Cet exposé est construit à partir d’un point de vue évidemment faux. Mais, à la manière dont la lumière et l’ombre sont liées dans l’exposition des rayons du Soleil sur la surface de n’importe quel objet terrestre, le faux se révèle inévitablement comme la face cachée du vrai. J’ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce lieu où de l’ombre naît de la lumière.
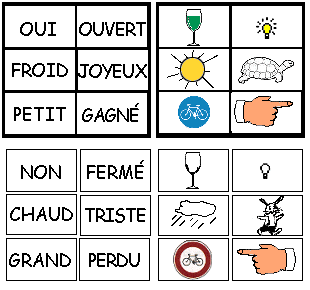
Il a fallu que l’homme écrive son histoire. La vivre ne lui a pas suffi. Pour remplir cet objectif, il a tendu, tend et tendra, comme je voudrais le montrer ici, à organiser les événements selon des classes bipolaires de concepts. La grande force de ce type de bipolarisations, c’est qu’on ne sait pas si elles ne font que présenter une construction épistémique statique à seule prétention de compréhension d’un phénomène ou si elles impliquent un mouvement dialectique ; il est néanmoins acceptable de poser que l’importance de leur diffusion ait une incidence essentielle sur la formation des représentations à l’enfance et donc sur l’activité qui s’exercera par la suite à l’âge adulte.
Mon argumentation s’appuiera sur trois exemples d’histoire particulière, sur lesquels je pense avoir acquis une connaissance assez large. Pour les besoins de la démonstration, j’historiciserai des propriétés que l’on se désigne généralement comme naturelles, inscrites dans l’état physique du monde. Par exemple, la distinction muet/parlant pour le cinéma est purement historique, puisqu’elle découle de l’effort humain en vue de sonoriser les films. A l’opposé, on pourrait observer que la distinction muet/parlant pour les êtres humains est tendanciellement biologique ; cependant, si la technologie venait à évoluer pour garantir à chacun l’usage de la voix, cette distinction prendrait un caractère historique, puisque sans doute elle engendrerait des changements psychologiques, économiques, sociaux, politiques considérables. Je pense que cette définition est assez claire.
Contemplons donc en premier lieu l’histoire du cinéma. On y verra se dégager deux courants principaux, à chaque occurrence :
1- Cinéma commercial (frères Lumière) / Cinéma d’art et essai (Buñuel)
2- Griffith (Etats-Unis) / Eisenstein (URSS)[1]
3- Muet / Parlant
4- Noir & Blanc / Couleur
etc. Une approche aussi élémentaire permet de distinguer sans grand mal les événements principaux qui ont dévié la course de cette industrie. Pour sortir de ce courant principal, on a bâti une solution théorique alternative sur la base du premier critère, qui particularise un peu plus l’approche, la rend plus proche d’une microscopique des faits importants. Dit plus précisément, on renverse la balance, on essaie de chercher dans les profondeurs obscures du passé des raisons de nuancer l’histoire principale narrée grâce aux trois derniers critères :
1- Théâtre filmé / Art cinématographique
2- Film grand public / Film excessivement violent ou pornographique
3- Blockbuster / Série B
4- Cinéma indépendant / Cinéma expérimental
etc. Je continue avec l’histoire de la musique, où là encore on fait valser les étiquettes avec une aisance indécrottable :
1- Classique / Populaire
2- Européenne / World
3- Mélodique / Rythmique
4- Commerciale / D’avant-garde
etc. On peut creuser plus profondément à partir de et contre ces premières conceptions pour dévoiler d’autres facettes de la chronologie :
1- Classique conventionnel / Classique contemporain
2- Musique tonale / Musique atonale[2]
3- Pop rock / Rock progressif
4- Vocale / Instrumentale[3]
etc. Je pourrais ajouter des distinctions comme vinyle/CD, a priori découlant de simples innovations techniques, mais auxquelles sont associés des usages sociaux différenciés de la matière et des typologies d’approche à la musique et à la collection.
Cela fait deux exemples triviaux, qui ne convaincront peut-être pas le lecteur le plus académique. Pour faire plus sérieux, considérons l’histoire de la sociologie, qui s’est bâtie sur une première distinction spontanée/scientifique[4] :
1- Durkheim / Weber[5]
2- Holisme / Individualisme
3- Explication / Compréhension
4- En chambre / Empirique
etc. A partir de ces chaînons élémentaires, on peut extraire des couples tels que :
1- Agent / Acteur
2- Structuralisme / Rationalisme
3- Statistiques / Entretien
4- Masculin / Féminin[6]
etc. En fin de compte, ce sont toujours des conceptions découlant des mêmes manières de penser, antiques, qui sont ’’dévoilées’’, en fait réinventées pour satisfaire à l’état actuel de l’activité humaine, c’est-à-dire, en fait, du progrès technique et culturel. Cette approche auto-complexifiante, qui touche autant le faire que sa connaissance, peut être perçue comme un frein à l’activité humaine. L’autonomisation d’un troisième monde d’idées, censé être celui de la connaissance objective (Popper), passe, pour beaucoup de personnes, pour une menace, qui jetterait notre espèce dans une concurrence impitoyable pour la survie. Contre elle, il y a eu des offensives célèbres. En France, par exemple, il y a eu la formation de l’Ecole des Annales. Grossièrement, si on écrivait une histoire de la musique populaire américaine du XXe siècle à la manière de l’Ecole des Annales, des concepts dégagés plus haut ne seraient jamais invoqués hors de toute sympathie envers le réel. L’attention du rédacteur se porterait sur les structures et la psychologie générale des protagonistes de l’histoire, plutôt que sur les individus célèbres qui sont censés avoir porté l’épopée humaine sur leurs seules épaules.
En effet, le projet de l’Ecole des Annales était d’éviter l’approche traditionnelle qui consiste à mettre en avant des personnages pour faire la narration de la vie des masses anonymes, de leurs activités, de leurs représentations. Pour s’en donner un exemple représentatif, on pourra consulter avec enthousiasme l’incroyable Société féodale de Marc Bloch, portant sur la période du IXe au XIIIe siècle de l’histoire de France. L’auteur y fait appel à de nombreux savoirs et méthodes de disciplines étrangères à l’histoire, notamment la sociologie durkheimienne, l’anthropotechnologie alors naissante et la psychologie. Les pages qu’il consacre à la psychologie générale de la population, notamment en démontant les effets de l’attente du 1er millénaire sur les masses dans le contexte christianisé de l’époque, restent parmi les plus instructives jamais écrites sur les tensions exercées par l’environnement à la fois sur l’homme et sur l’humanité, moulées dans une optique simultanément singulière et collective. La richesse de sa description est si grande qu’on se demande si Bloch ne déborde pas parfois de l’apport de ses sources, rares il est vrai, pour se réfugier dans son imaginaire.
C’est à se demander si, lorsque le champ des bipolarisations est trop étroit ou devient trop large, l’histoire sort du champ de la science pour s’exprimer dans le littéraire, voire dans la romance. Il faudrait savoir exactement quelles sont les conditions possibles de l’écriture de l’histoire. Si je devais faire une hypothèse, je dirais que l’historien ne fait pas seulement avec les sources disponibles au temps y et au lieu x de sa recherche, mais également avec les classes de concepts disponibles. Ce n’est pas son art combinatoire, toujours rudimentaire, qui change ou évolue au cours du temps, c’est la multitude des paires antithétiques de concepts présentes à mettre en travail qui modifie ses aptitudes à remodeler les aspects de sa narration, préparant par là le chemin à d’autres penseurs. Si, dans la pratique de recherche, « à tout concept scientifique doit s’associer son anti-concept » (Bachelard), il en est de même dans l’histoire, laquelle est elle-même une recherche toujours renouvelée de sens, de résolution de problèmes. Les concepts et les sources n’existent pas séparément.
Si je devais simplifier excessivement ma pensée à la fin de cet exposé, je dirais qu’il n’est pas possible de faire du neuf autrement qu’avec du vieux, et que ce neuf sera toujours, nécessairement, plus dense que le vieux qui lui a servi de propulseur. Si les conditions de la co-construction de la connaissance s’améliorent, et elles le feront, ce sera en vue de poursuivre cette course effrénée vers le nouveau, l’inconnu, l’indicible. Je gage tranquillement que la frontière entre histoire et littérature ira en s’estompant. Espérons simplement que ce ne sera pas au détriment de ceux qui ne sauront plus lire par la faute de tuteurs seulement intéressés à leur propre plaisir. Savants universitaires et travailleurs du quotidien partagent assurément le besoin de résoudre des problèmes, à moins qu’ils ne soient intéressés excessivement, voire exclusivement, par leur confort matériel immédiat.
La majorité des capitalistes d’aujourd’hui insistent beaucoup sur la mobilité de leurs employés et discriminent en nombre les « immobiles », car ils croient que la facilité de trouver des outils et de réaliser des objets simples à partir de l’art combinatoire rudimentaire peut remettre en cause leur légitimité à conduire le progrès. Tous n’ont pas conscience que les objets et concepts disponibles sont si nombreux qu’une organisation par l’autorité n’est plus indispensable. L’histoire va dans une direction déterminée ; la somme d’objets à entretenir est telle que l’activité de travail est devenue une nécessité de la vie. A eux de savoir y prendre leur place s’ils ne veulent pas que d’autres ne leur la volent.

