De l’orthographe comme instrument d’égalité
-“Est-ce que l’Hortographe, c’est le type qui compose les jardins ? et le Fotographe celui qui écrit avec des fautes ?”
-“Quand les mots ne sont pas exacts, les jugements ne sont pas clairs, les oeuvres ne prospèrent pas, et le peuple ne sait plus où il en est...” répondrait Confucius.
Je suis violemment contre toute tentative de réforme artificielle de l’orthographe française.
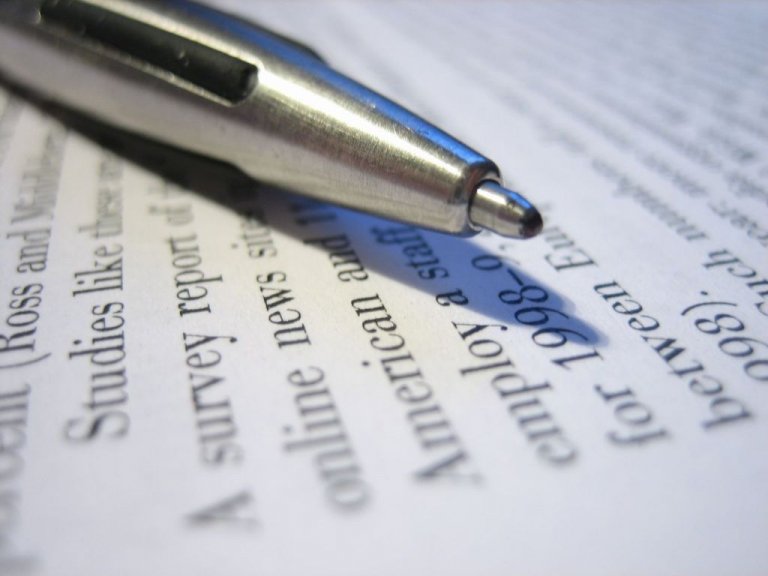
Faut-il être inconscient de la fracture sociale que cela va engendrer pour accepter que le français soit ramené à une sorte de nouveau créole ? Car au fond, le français tel que François de Closets l’a présenté sur France 2 hier soir, c’est Péguy et Genet ensemble au rayon des curiosités, c’est le nivellement par le bas, le découragement de l’effort.
L’affaire est d’importance, et même de salubrité publique, car on n’est plus au temps de Robert Estienne qui, au XVI° siècle déjà, s’employa dans son “dictionnaire francoislatin” à en réformer la notation. Mais cela ne concernait même pas 20% de la population.
On semble regretter de manière saisonnière, et peut-être au même rythme que le niveau d’illétrisme s’accroît dans la population, que le français a une complexité graphique, à peine plus que l’espagnol ou l’italien, et grammaticalement moins complexe que l’allemand, et l’on prétend que cette orthographe complexe nuit aux jeunes et au plus défavorisés, par la sévérité des examinateurs, que l’orthographe joue le rôle de censeur, d’élément discriminant. Mais tous les codes ont des règles ! en mathématiques aussi il y a une orthographe, et sur la route un code du même nom !
Tiens : comment écrit-on “humble” ? Pourquoi un “H”, un “U”, et un “M” ? Ne pourrait-on pas écrire “ainble“ ? ou “inble” ? Mais alors comment la personne qui aura écrit “inble” toute sa vie pourra faire le lien, dès qu’elle verra le terme écrit, avec l’adjectif qui s’y rapporte : l’humilité ? (humilitas, humilitatis : de basse condition) ...
En réformant brutalement l’orthographe, on s’attaque à la racine des mots, à l’histoire des mots, et donc à la possibilité de les associer entre eux, d’en toucher leur parenté, de pouvoir en jouer. Et ça heurte aussi une partie de notre identité francophone.
Déjà que la méthode globale a empêché toute une génération de faire des liens par association avec des mots que la personne n’avait jamais croisés, mais alors là... elle est définitivement condamnée à piocher dans les ressources de son vocabulaire de base sans pouvoir l’élargir !
Et justement, parlons-en, des humbles, des gens de peu de condition.
De Closets, dans une diatribe confuse à laquelle il ne nous a guère habitués (y croit-il lui-même ?) prend Diderot en exemple : il griffonnait des lettres à l’orthographe fantaisiste, nous dit-il, alors qu’il n’aurait pas toléré la moindre faute dans son encyclopédie. VRAI ! à un détail près. C’est que l’auteur de Jacques et son maître maîtrisait les nuances de la langue française mieux que personne, sa pensée ne faisait pas défaut, et elle s’abreuvait aux sources latines et grecques du français ; M. Diderot en maîtrisait son étymologie. Il n’écrivait pas une lettre truffée de fautes à défaut de savoir mieux s’exprimer.
Ce qui le distingue d’avec un “jeune d’aujourd’hui” ou disons plutôt un ignorantin moderne (d’autres ont dit “sauvageon”, mais c’est la même chose) c’est sa pratique assidue et intéressée de la lecture, son accès à l’enrichissement de sa pensée, de sa culture poétique ou littéraire, mais aussi politique. Toutes façons d’appréhender le monde à travers celui des autres.
Or, allons-y ! Complaisons à la facilité, et aucun adolescent de banlieue ni de la ville ne pourra plus accéder à Jaurès ou Hugo, car il ne s’en trouvera plus un seul pour aller vers la langue de Jaurès et de Hugo, et d’ en saisir leur pensée ! Il suffit de lire la lettre que Jaurès adressait à des instituteurs, et l’on se rend compte de la distance déjà parcourue. "Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée, très générale il est vrai, mais très haute de l’histoire de l’espèce humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre de la terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l’humanité". La Dépêche de Toulouse, 15 janvier 1888. Pensez donc, le XIX° siècle ? Une antiquité !
Voilà qui en arrangerait bien certains, qui continueront de posséder la langue, non contents d’avoir été les héritiers des biens matériels !
Je n’ai pas envie de lire votre livre M. De Closets, et pas parce que j’aurais peur d’y trouver des fautes. Je trouve votre intervention parfaitement déplacée à notre époque du tout-au-rentier. Qu’il y ait ceux qui savent lire, et ceux qui ne le savent plus ; voilà qui achèverait un fameux cycle depuis la société pré-industrielle.
Je comprends votre souffrance, car j’ai un ami qui se trouve handicapé par cette difficulté à bien orthographier, mais je crois que vous vous trompez de cible. Ce n’est pas le français que vous devriez accuser d’être trop difficile, ni les jeunes d’être inaptes à aller vers la complexité de notre langue, c’est vos enseignants des petites classes que vous devriez accuser d’avoir été trop peu les dépositaires d’une bonne méthode, d’une obédience à leur langue, et peut-être de ne pas vous avoir montré sa qualité écrite, en un mot, de ne pas avoir pu ou su faire leur métier.
Mais par dessus-tout, je voudrais vous demander une chose : à défaut de leur donner accès à un patrimoine matériel, laissez au moins à ceux qui ne sont pas nés au bon endroit la chance d’accéder un patrimoine immatériel, c’est-à-dire une Langue !
sur le mot orthographe : http://www.dico-definitions.com/dictionnaire/definition/23219/Orthographe.php
un bloggueur
http://carnet.causeur.fr/antidote/ou-vit-francois-de-closets,00376
Lettre aux instituteurs, Jean Jaurès


